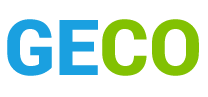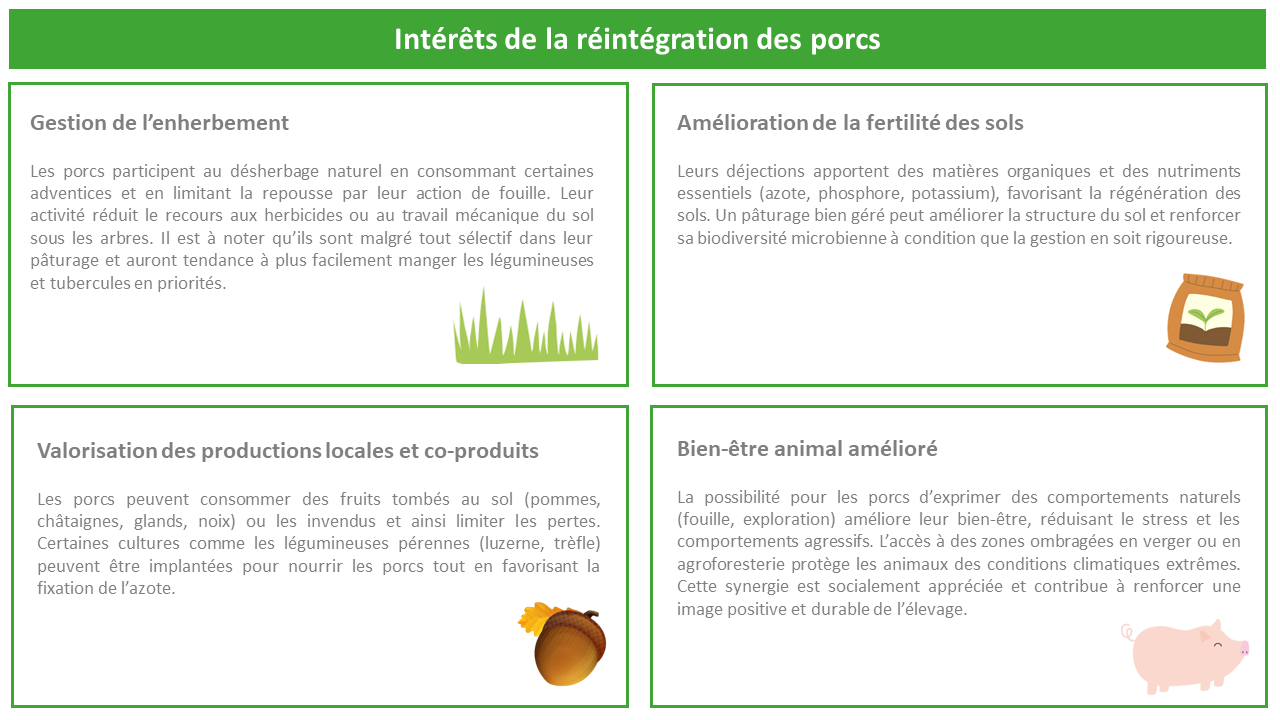Les élevages porcins et leurs caractéristiques
Les systèmes d’élevage porcins sont variés, allant du modèle intensif en bâtiments à des formes plus extensives (élevage en plein air ou en agroforesterie). Classiquement, les porcs sont élevés dans des bâtiments contrôlés pour optimiser leur croissance et minimiser les risques sanitaires. Cependant, face aux enjeux environnementaux et sociétaux croissants, les systèmes d’élevage en extérieur connaissent un regain d’intérêt, notamment pour leur compatibilité avec des pratiques agroécologiques.
On distingue plusieurs types d’élevage porcin :
- Naisseurs-Engraisseurs (NE), qui élèvent les truies reproductives et engraissent les porcs qu’elles ont mis bas.
- Engraisseurs (E), qui achètent des porcelets sevrés pour les engraisser.
- Naisseurs (N) qui élèvent des truies reproductrices et vendent les porcelets au sevrage
La conduite d’atelier porcin se distingue par sa conduite en bande : quel que soit le nombre d’animaux total, ceux-ci sont regroupés par lot d’un même stade physiologique (ex : les truies d’une même bande vont mettre bas en même temps) afin de rationaliser les phases d’élevage et les départs à l’abattoir. En pratique, on peut retrouver des conduites en deux ou trois bandes comme des conduites en sept ou plus.
L’élevage porcin, très technique, requiert des connaissances approfondies sur la physiologie de l’animal et la gestion des différentes phases d’élevage. Si plusieurs guides spécialisés existent, l’élevage de porcs en plein-air se distingue grandement d’une conduite classique en bâtiment et requiert des connaissances spécifiques. Les guides « Truies bio en plein air » (CAPDL), « Elever des porcs en bio » (FNAB) et « Alimentation des porcins en agriculture biologique » (ITAB) peuvent fournir une bonne première approche.
L’élevage porcin en plein air
L’élevage de porcs en plein air se distingue par une gestion plus extensive des animaux, leur permettant d’exprimer pleinement leurs comportements naturels (fouille du sol, déplacements, interactions sociales). Ce système repose sur plusieurs principes fondamentaux :
- Accès à des parcours extérieurs, souvent en rotation, pour éviter le surpâturage et la dégradation des sols (le porc est animal fouisseur)
- Alimentation diversifiée, mixant fourrages et concentrés
- Protection sanitaire et bonne gestion des effluents, pour limiter les risques de contamination et préserver la fertilité du sol. La prise en compte de la biosécurité est essentielle
- Adaptation des races : les races rustiques (ex. Porc Basque, Gascon, Duroc, Porc Blanc de l’Ouest, Porc de Bayeux, Large Black) sont privilégiées pour leur robustesse et leur capacité à valoriser des ressources locales. En vente directe, leurs produits sont généralement bien valorisés pour leurs qualités organoleptiques (gras, persillé, couleur, etc.).

Quels avantages et quels inconvénients ?
L’association des porcs aux cultures pérennes (vergers, vignes, agroforesterie) est une alternative intéressante pour optimiser l’espace agricole et valoriser les complémentarités entre productions. Ces systèmes s’inspirent de pratiques traditionnelles comme la « dehesa » espagnole (élevage de porcs sous chênes).
Les porcs sont particulièrement utiles dans les plantations pour leur capacité à retourner le sol en fouissant, ce qui permet d’aérer la terre et de réduire les populations de nuisibles. De plus, ils se nourrissent des fruits tombés, aidant ainsi à limiter les maladies liées aux pourritures. Leurs déjections enrichissent également le sol. Cependant, leur fouissage intense peut nuire aux racines des arbres et déstabiliser certaines zones du verger ou de la vigne. Il est donc recommandé de limiter leur accès aux zones sensibles, d'utiliser des enclos solides pour contrôler leur activité et de les faire pâturer par cycles courts afin d'éviter des dégâts importants.
|
|
|
|

|
| Déterminer ses objectifs
|
|
| Choix des animaux Privilégiez des races rustiques et adaptées au pâturage (races locales, Gascon, Basque, Porc Blanc de l’Ouest, de Bayeux, Duroc, etc.) moins exigeantes en compléments alimentaires et plus résistantes aux conditions extérieures. Sélectionnez des animaux en fonction de la gestion du pâturage, de la capacité de rotation de vos parcelles, de la portance de votre sol et de votre capacité de mise en place de clôtures de biosécurité. Il faudra également veiller au chargement de votre parcelle en fonction du type d’animaux et de la race. |
|
| Aménagement des parcelles
|
|
| Installer des infrastuctures adaptées
|
|
| Une gestion de l'alimentation relativement pointue
|
|
| Des plans de biosécurité et de gestion sanitaire clairement définis
|
|
| Assurer une rentabilité et des débouchés commerciaux
|

Sur les porcins, trois types de ressources co-existent : des documents génériques sur l’introduction d’animaux dans les systèmes végétaux, des documents sur les systèmes porcins plein air (projets SECALIBIO et VALORAGE par exemple) et d’autres, plus rares, sur les porcins dans les vergers ou les vignes.
FICHES ET GUIDES TECHNIQUES
- Les systèmes parcours porcins arborés
- L’introduction d’animaux en vergers et en vignes : un moyen de réguler des bioagresseurs ?
- Pâturage en verger
- L'élevage porcin en plein air intégrés aux cultures énergétiques
- Les parcours et les fourrages pour les porcs biologiques : projet VALORAGE
- Les parcours et les fourrages pour les porcs biologiques : projet SECALIBIO
VIDEOS COURTES
- Pâturage tournant des truies gestantes
- Pâturage tournant des porcs charcutiers à la ferme du Cochon bleu
- Le cochon Kune Kune : Un allié en agroforesterie
- Des cochons Kune Kune dans la vigne pour aérer les sols
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|