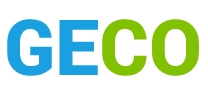Associer des cultures avec des espèces annuelles
Cette fiche est reliée à d'autres thématiques de la manière suivante :

Association céréales protéagineux
Crédit : Arvalis Institut du végétal
1. Présentation
Caractérisation de la technique
Description de la technique :
L'association d'espèces annuelles est une culture simultanée de deux espèces annuelles ou plus sur la même surface. Les espèces ne sont pas nécessairement semées et récoltées en même temps mais doivent cohabiter pendant une période significative de leur croissance. Les plantes peuvent être mélangées dans la parcelle (semis d'un mélange de graines ou semis en plusieurs fois), ou cultivées en rangs ou bandes alternées.
En grandes culture, les cultures peuvent être récoltées ou non en grains secs, en foin, voire en ensilage par les éleveurs ou les céréaliers (alimentation du troupeau, assez fréquente ou commercialisation, moins fréquente). Le choix des espèces est fonction des débouchés possibles, des caractéristiques physiologiques des espèces associées (précocité, hauteur) afin de récolter le mélange dans de bonnes conditions, et des objectifs recherchés (limiter le salissement, éviter les maladies, résistance à la verse, etc).
Précision sur la technique :
Quelques exemples :
La complémentarité se fait avant tout sur la nutrition azotée : la céréale utilise l’azote présent dans le sol et par compétition, pousse ainsi la légumineuse à maximiser la fixation symbiotique de l’azote présent dans l’air. Les deux types de cultures ont également des systèmes racinaires et des ports différents qui permettront d’optimiser l’utilisation des ressources (lumière, eau, éléments nutritifs).
Le choix des espèces et leur proportion dans le mélange dépendront ensuite des objectifs visés :
-
-
Si l’objectif est la production d’un protéagineux, la céréale peut être associée en faible quantité et jouera un rôle de plante de services, avec une compétitivité plus forte que le protéagineux et donc une meilleure maitrise des adventices, une sécurité en cas d’accident sur le protéagineux et un effet tuteur dans le cas particulier du pois ou de la lentille (voir résultats projet PROGRAILIVE) ex : féverole + triticale, pois + blé, orge + lentille
-
-
-
Si l’objectif est d’avoir un mélange équilibré en énergie et en protéines pour l’alimentation animale, alors les deux cultures peuvent être semées en proportions égales. Ces mélanges comportent généralement plus de deux cultures. Elles ont l’avantage d’être très couvrante et de nécessiter peu, voire pas d’intervention. Elles peuvent être récoltées en ensilage (Mélange Céréales Protéagineux Immatures) ou en grains (voir résultats projet 4AGEPROD). Dans le cas des MCPI, une prairie peut même être semée en association avec le mélange. Elle pourra se développer après la récolte de ce dernier et permettra une meilleure implantation de la prairie. Ex : triticale + féverole + avoine + vesce, pois fourrager + triticale
-
-
-
Si l’objectif est de produire un blé riche en protéines, il peut être associé à un pois ou une féverole, afin d’augmenter son taux de protéines. Cette technique est encore à l’essai, et uniquement pour l’agriculture biologique, mais elle tend à se développer.
-
L’itinéraire technique est évidement à adapter en fonction des cultures présentes. Exemple de mise en œuvre : Pour l'ensilage (BRUNSCHWIG et al. 2009).
| Semis | Semer fin octobre - début novembre en sol sain et profond un mélange triticale / pois fourrager / vesce respectivement à 290, 15 et 15 grains/m². Semer à 2-3 cm de profondeur. |
| Désherbage, fertilisation, irrigation | Pas d'apport d'azote minéral si épandages de matière organique à l’implantation ou si reliquat de plus de 50 unités à la sortie de l’hiver. Dans le cas contraire, 50 à 60 unités d’azote maximum apportés à partir du stade épi 1 cm du triticale (mi-mars). Aucune spécialité commerciale n’est homologuée pour cette culture. |
| Gestion du couvert, destruction, récolte | Récolter avec séchage 1 ou 2 jours si récolte précoce ou récolte directe dans la journée si tardive. |
Points de vigilance :
Il est important dans le cas d’une récolte en grains en mélange, et si le tri est nécessaire, de choisir des tailles de graines différentes permettant une bonne séparation. De même, il est important de vérifier la possibilité de tri chez le collecteur ou même s’il accepte de collecter le mélange (ex : le mélange blé meunier + pois est souvent refusé par risque d’avoir des brisures de pois dans le blé, ce qui nuirait à ses qualités technologiques pour l’aval).
Si l’objectif est de récolter toutes les cultures associées, il est important de choisir des espèces et des variétés qui permettent une maturité synchronisée. Inversement, il faudra prêter attention à ne pas choisir une plante de services non récoltée qui resterait trop verte à la récolte de la culture principale (ex : association du soja au sarrasin). Si les associations d'espèces semblent en général moins sensibles aux bioagresseurs, cet effet est variable et à étudier au cas par cas. Certains bio-agresseurs sont parfois favorisés, par exemple les pucerons attirés par des céréales riches en azote dans une association céréales-légumineuses ou les maladies du pied des céréales favorisées par un microclimat humide lié à la densité du couvert.
- Des associations colza-plantes compagnes
La complémentarité se fait aussi pour les ressources en azote. La compétitivité du colza pour l’azote pousse les légumineuses associées à privilégier la fixation symbiotique pour assurer leurs besoins azotés et permet ainsi d’optimiser le fonctionnement de l’association. De plus, les légumineuses présentent une bonne complémentarité d’enracinement avec le colza et permettent de réduire les dégâts d’insectes. Il est aussi possible d’inclure des espèces non-légumineuses dans le mélange. Terres inovia préconise un couvert gélif, qui produit de la biomasse, concurrence les adventices, perturbe les insectes, minéralise l’azote au printemps, améliore les composantes de la fertilité du sol.
Points de vigilance :
Il faut éviter d’inclure dans le mélange des espèces présentent en culture principale dans la rotation. Dans les parcelles à risques, il est recommandé de choisir des espèces non-hôtes ou des variétés résistantes à aphanomycès afin de ne pas multiplier l’inoculum.
Autres exemples d'associations de cultures : maïs/orge, lentille/cameline, etc. Les cultures associées peuvent être utilisées dans le cas de cultures intermédiaires pluri-spécifiques pour remplir des fonctions cumulées d’engrais vert, de piège à nitrate et d’éventuellement réguler les populations de bioagresseurs pour la culture suivante. Ex : radis/moutarde/lin/phacélie/féverole/vesce/navette.
Période de mise en œuvre
Echelle spatiale de mise en œuvre
Application de la technique à...
Toutes les productions : Généralisation parfois délicateLa composition du mélange doit tenir compte du comportement de chaque espèce, pour minimiser les phénomènes de concurrence, qui peuvent aboutir à l'élimination de certaines espèces, et maximiser la complémentarité des espèces entre elles voire les phénomènes de facilitation lorsqu'ils existent. Cette technique est plus développée dans les élevages en recherche d'autonomie.
Tous les types de sols : Généralisation parfois délicate
Certaines espèces de plantes sont à éviter sur sols hydromorphes. Sur les sols hydromorphes, les associations céréales - légumineuses peuvent rencontrer un problème de pertes hivernales de pieds de légumineuse qui déséquilibre le mélange.
Une association entre une céréale et une luzerne (en semis sous couvert vivant) nécessite par exemple de tenir compte de la teneur en calcaire actif et du pH.
Dans des parcelles très hydromorphes, l’association avec une féverole (système racinaire pivotant) permet toutefois de préserver la qualité racinaire du colza qui soufre moins de l’asphyxie.
Tous les contextes climatiques : Facilement généralisable
La réduction de l'impact des maladies est liée à l'année climatique : plus la pression maladie est forte, plus le mélange est intéressant et valorise les différences de sensibilité entre les espèces.
Réglementation
La mise en place d'une association de légumineuses gélives ou d'un couvert de légumineuses gélives et non gélives fait l'objet de fiches CEPP :
- Action n°10 : Remplacer les traitements herbicide et insecticide d'automne en associant des légumineuses gélives avec du colza d'hiver
- Action n°50 : Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en associant un couvert de légumineuses gélives et non gélives entre rangs de colza
Il est possible de déclarer son colza en SIE dans le cadre de la PAC.
2. Services rendus par la technique
Régulation et gestion des adventices
Gestion des ravageurs
Gestion des maladies
Gestion des auxiliaires ennemis des bioagresseurs
Gestion des auxiliaires pollinisateurs
Stockage et gestion de l'eau
Fourniture de nutriments
Stabilité physique et structuration du sol
Régulation du climat local
3. Effets sur la durabilité du système de culture
Critères "environnementaux"
Effet sur la qualité de l'air : En augmentationL'effet peut être direct (effet barrière sur la dérive). Toutefois, il est plutôt indirect, en limitant l'usage de produits phytosanitaires et en particulier les herbicides sauf si destruction chimique du couvert.
Effet sur la qualité de l'eau : En augmentation
Diminution de l’usage de produits phytosanitaires, sauf si destruction chimique d'une des cultures, et d'engrais azotés si mélange d'espèces avec légumineuses (ex. triticale/pois).
Effet sur la consommation de ressources fossiles : Variable
Diminution vraisemblable des GES si réduction du nombre de passage et des apports d'engrais, qui seront toutefois nécessaires dans le cas des couverts d’interculture. Diminution du nombre de passages mécaniques, et éventuellement de l'utilisation d'engrais si introduction de légumineuses.
Critères "agronomiques"
Productivité : En augmentationRendement du mélange généralement supérieur à celui des espèces pures cultivées séparément. Le rendement du mélange est aussi plus stable d'une année à l'autre (moindre sensibilité au stress climatique).
Qualité de la production : Pas d'effet (neutre)
La teneur en protéines des céréales du mélange est généralement améliorée. Toutefois, il est difficile de prévoir la proportion des différentes espèces à la récolte.
Fertilité du sol : En augmentation
Les associations, qu’elles soient un couvert d’interculture ou en culture principale, peuvent augmenter la fertilité physique, chimique et biologique du sol. En effet, elles permettent une exploration plus complète des horizons du sol, de fixer ou augmenter la disponibilité des éléments nutritifs ainsi que la vie biologique et la matière organique du sol.
Stress hydrique : En diminution
Les cultures associées sont souvent plus résistantes à la sécheresse que les cultures d'espèce unique.
Biodiversité fonctionnelle : En augmentation
Augmentation de la biodiversité végétale domestique et diversification des habitats et ressources offerts par l'agro-écosystème. Augmentation de la diversité intra-parcellaire et probablement de la biodiversité sauvage associée.
Maîtrise des bioagresseurs : Variable
Si les associations d'espèces semblent en général moins sensibles aux bioagresseurs, cet effet est variable et à étudier au cas par cas. Certains bio-agresseurs sont parfois favorisés, par exemple les pucerons attirés par des céréales riches en azote dans une association céréales-légumineuses ou les maladies du pied des céréales favorisées par un microclimat humide lié à la densité du couvert.
Critères "économiques"
Charges opérationnelles : Variable
Diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires et/ou d'engrais azotés si mélange d'espèces avec légumineuses (ex. triticale/pois). Il faut toutefois prendre en compte les couts liés aux semences de la légumineuse. Par exemple, une association d’hiver triticale-pois fourrager, le total des charges opérationnelles s’élèvent à 321€/ha brut (Opaba, 2005).
Charges de mécanisation : En diminution
Réduction du nombre de passage liés à l’usage de produits phytosanitaires et aux engrais. Toutefois, le semis peut parfois nécessiter deux passages.
Marge : Variable
Variable selon les conditions climatiques de l'année, les prix de vente et la valorisation du mélange car :
1) diminution des charges phytosanitaires (au moins poste fongicide) mais
2) peut s'accompagner d'un coût supplémentaire de tri des graines à la récolte.
Ces mélanges sont très intéressants pour une valorisation en consommation animale (ensilage, fourrage ou récolte en grains).
Débouchés : Variable
Certains mélanges nécessitent d'être triés avant commercialisation, ce qui engendre un coût supplémentaire. Tous les types d'associations ne sont pas acceptés par les organismes collecteurs et certaines céréales peuvent être déclassées si elles sont associées à des protéagineux (risque de brisures de pois par exemple dans le blé meunier).
Critères "sociaux"
Temps de travail : En diminution
Réduction du nombre de passages dans la parcelle. Les maladies étant retardées et freinées, le risque "d'accident cryptogamique majeur" est nettement diminué. Ceci induit un "besoin de surveillance" à la baisse, et peut autoriser un programme fongicide allégé déclenché à un stade bien choisi.
Possibilité d'un temps de réglages plus long de la moisson pour les récoltes en grains + travail supplémentaire si le tri se fait à la ferme.
Période de pointe : Variable
Plage d'intervention courte pour l'ensilage de céréales-légumineuses et la valorisation en élevage en général.
Effet sur la santé de l'agriculteur : En augmentation
Diminution du risque d'exposition aux pesticides pour les applicateurs.
4. Organismes favorisés ou défavorisés
Bioagresseurs favorisés
| Organisme | Impact de la technique | Type | Précisions |
|---|---|---|---|
| oïdium des céréales | MOYENNE | agent pathogène (bioagresseur) | Favorisé ou défavorisé selon les associations, cf. Rusch 2006. |
Bioagresseurs défavorisés
| Organisme | Impact de la technique | Type | Précisions |
|---|---|---|---|
| Botrytis | MOYENNE | agent pathogène (bioagresseur) | |
| alternariose sur tomate | MOYENNE | agent pathogène (bioagresseur) | Cité dans un document en lien avec l'association roses d'inde - tomate |
| altise du colza | FAIBLE | ravageur, prédateur ou parasite | Grosses altises du colza semblent réduites aussi mais encore à l'état de piste (document CRA de Poitou Charente). |
| anthracnose du pois | MOYENNE | agent pathogène (bioagresseur) | |
| helminthosporiose de l'orge | MOYENNE | agent pathogène (bioagresseur) | |
| mouche du chou | FAIBLE | ravageur, prédateur ou parasite | Mouche du chou réduite sur les associations choux / trèfles (Finch et al., 2003). |
| nématode (bioagresseur) | MOYENNE | ravageur, prédateur ou parasite | On sait uniquement que les cultures associées peuvent réduire la pression nématode (sans précisions sur les différentes espèces). |
| oïdium des céréales | MOYENNE | agent pathogène (bioagresseur) | Favorisé ou défavorisé selon les associations, cf. Rusch 2006 |
| pucerons des crucifères | MOYENNE | ravageur, prédateur ou parasite | |
| sitone du pois | MOYENNE | ravageur, prédateur ou parasite | Effet dilution démontré dans un mélange avoine - pois. |
Auxiliaires favorisés
| Organisme | Impact de la technique | Type | Précisions |
|---|---|---|---|
| Carabes prédateurs et granivores | MOYENNE | Ennemis naturels des bioagresseurs | Carabes prédateurs de parasites de l'orge favorisés dans la cas d'une association orge-pois ou orge-navets. |
Auxiliaires défavorisés
| Organisme | Impact de la technique | Type | Précisions |
|---|
Accidents climatiques et physiologiques favorisés
| Organisme | Impact de la technique | Précisions |
|---|
Accidents climatiques et physiologiques défavorisés
| Organisme | Impact de la technique | Précisions |
|---|
5. Pour en savoir plus
6. Mots clés
Méthode de contrôle des bioagresseurs : Contrôle cultural
Mode d'action : Atténuation
Type de stratégie vis-à-vis de l'utilisation de pesticides : Reconception
Contributeurs
charge-mission - celine.bourlet@pl.chambagri.fr